Julius Fučík : Récit de l'arrestation
Submitted by Anonyme (non vérifié)Dans cinq minutes la pendule va sonner dix heures, c'est un beau soir frais de printemps, exactement le 24 avril 1942. Je me dépêche, dans les limites de mon rôle, celui d'un monsieur âgé qui boite – je me dépêche d'arriver chez les Jelinek avant la fermeture de la maison.
J'y suis attendu par mon second, Mirek. Je sais que cette fois-ci, il n'a rien d'important à me dire, ni moi non plus, mais manquer un rendez-vous pourrait entraîner la panique – et il faut précisément éviter d'inutiles soucis aux deux bonnes âmes qui nous accueillent.
Ils me reçoivent avec une tasse de thé. Mirek attend déjà – en plus, il y a le ménage Fried. Encore une imprudence. J'aime bien vous voir, camarades, mais pas ainsi ensemble. C'est le meilleur chemin pour la prison et la mort.
Ou vous respectez les règles de la conspiration, ou vous cesserez de travailler, parce que vous vous menacez vous-même, et les autres. Avez-vous compris ? — Compris. — Que m'avez-vous porté ? — Le numéro du le mai du Rudé Pravo. — Très bien, et toi, Mirek ? — Ça va, rien de nouveau, le boulot avance bien. — Fini. on se retrouvera après le 1er mai, je vous laisserai un mot, au revoir. — Encore une tasse de thé, patron. — Mais non, non, madame Jelinek, nous sommes ici trop nombreux. — Une petite tasse au moins, je vous prie.
La vapeur s'élève du thé fraîchement versé. Quelqu'un sonne. À ce moment dans la nuit ? Qui serait-ce donc ?
Les visiteurs sont impatients. Des coups sur la porte.
 — Ouvrez, Police. — Vite aux fenêtres, fuyez. J'ai des revolvers, je vais couvrir votre fuite.
— Ouvrez, Police. — Vite aux fenêtres, fuyez. J'ai des revolvers, je vais couvrir votre fuite.
Il est trop tard, la Gestapo est déjà sous les fenêtres, les pistolets pointés dans notre direction.
En forçant les portes, en traversant le couloir, les flics pénètrent rapidement dans la cuisine, puis dans la chambre. Un, deux, trois, neuf hommes.
Ils ne me voient pas parce que je suis derrière leur dos, derrière la porte qu'ils ont ouverte. Je peux donc tirer à mon aise mais leurs neuf pistolets sont braqués sur deux femmes et trois hommes sans armes, si je tirais le premier, ils tomberaient avant moi et même si je voulais tirer contre moi, la fusillade commencerait et ils en seraient les premières victimes.
Si je ne tirais pas, on les enfermerait pour six mois, pour un an peut-être et la Révolution les libérerait. Seuls Mirek et moi n'avons pas de chance de nous en sortir, ils vont nous torturer – ils ne tireront rien de moi.
Et de Mirek ? L'homme, l'ancien combattant de l'Espagne républicaine, l'homme qui a fait deux ans de camp de concentration en France et qui, en pleine guerre, est passé illégalement de France à Prague, non, celui-là ne trahira pas.
 J'ai deux secondes pour réfléchir, ou bien serait-ce trois secondes ?
J'ai deux secondes pour réfléchir, ou bien serait-ce trois secondes ?
Si je tirais, je ne sauverais rien, je me garderais des tortures mais je sacrifierais inutilement les vies de quatre camarades. Est-ce bien cela ? Oui. C'est décidé. Je sors de ma cachette.
— Ah, en voilà encore un. Premier coup dans la figure, c'était peut-être pour me mettre knock-out. Hände auf ! (Haut les mains !) Deuxième, troisième coup. C'est bien ce que j'avais imaginé. D'un appartement en ordre, il ne reste plus maintenant qu'un fouillis de meubles cassés, de vaisselle brisée.
De nouveaux coups de poing et de pied. Marsch ! (Marchez !) Ils m'ont mis dans la voiture, le pistolet toujours pointé sur moi. Pendant le voyage, on commence l'interrogatoire.
— Qui es-tu ?
— Le professeur Horak.
— Tu mens.
Je hausse les épaules.
— Assieds-toi ou je tire !
— Tirez.
Mais à la place d'une balle, un coup de poing.
Nous passons à côté d'un tramway, il me semble qu'il est couronné de fleurs blanches. Un tramway de noces, maintenant, en pleine nuit ? C'est la fièvre qui commence, je pense.

Le palais de Petschek, j'avais espéré n'y entrer jamais vivant, maintenant au galop au quatrième étage. Ah ! le trop fameux bureau II A I, la section anticommuniste. Il me semble que je suis même curieux.
Le commissaire long et maigre qui a mené l'opération de cette équipe spéciale contre nous, met son pistolet dans sa poche et me prend avec lui dans son bureau. Il m'allume une cigarette. — Qui es-tu ? — Professeur Horak. — Tu mens.
La montre de son poignet indique onze heures. — Fouillez-le. On commence à me fouiller, on me déshabille. — Il a des papiers. — À quel nom ? — Professeur Horak. — Faites prendre des renseignements.
Le téléphone sonne.
— Évidemment, il n'est pas déclaré, les papiers sont faux. — Qui te les a donnés ? — La direction de la police.
Premier coup de bâton. Deuxième. Troisième. Est-ce que je dois les compter ? Mon garçon, tu ne publieras cette statistique nulle part.
— Ton nom ? Parle ! Ton adresse ? Parle ! Avec qui étais-tu en rapport ? Parle ! Les logements ? Parle ! Parle ! Sinon nous te battrons jusqu'à la mort.
Combien de coups un homme sain peut-il supporter ? À la radio, on entend sonner minuit, on ferme les cafés, les derniers clients s'en vont à la maison, les amoureux piétinent sur place devant les portes et ne se décident pas à se dire au revoir.
Le commissaire long et maigre entre dans la pièce avec un sourire gai.
— Tout va bien, monsieur le Rédacteur ?
Qui leur a dit cela ? Jelinek ? Les Fried ? Mais ils ne connaissent pas mon nom.
— Tu vois nous savons tout. Parle... Sois intelligent.
 Quel raisonnement ! Être intelligent : trahir. Je ne suis pas intelligent.
Quel raisonnement ! Être intelligent : trahir. Je ne suis pas intelligent.
— Ligotez-le ! Et passez-le encore à tabac.
Il est une heure, les derniers tramways rentrent au dépôt. Les rues se vident, la radio souhaite bonne nuit à ses plus fidèles auditeurs.
— Qui est encore membre du Comité central ? Où sont les postes d'émissions ? Où sont les imprimeries ? Parle ! Parle ! Parle !
Maintenant je peux compter les coups plus tranquillement, la seule douleur que je sente, c'est la morsure de mes dents sur mes lèvres.
— Déchaussez-le.
C'est vrai. la plante des pieds est encore sensible. Je le sens maintenant. Cinq, six, sept, c'est maintenant comme si le bâton me traversait jusqu'au cerveau.
Deux heures, Prague dort, peut-être quelque part l'enfant vagit et l'homme caresse le flanc de la femme.
— Parle ! Parle !
 Je passe ma langue sur mes gencives et j'essaie de compter les dents cassées. Je ne peux pas achever mon calcul. Douze, quinze, dix-sept ? Non, c'est le nombre de commissaires qui m'interrogent maintenant.
Je passe ma langue sur mes gencives et j'essaie de compter les dents cassées. Je ne peux pas achever mon calcul. Douze, quinze, dix-sept ? Non, c'est le nombre de commissaires qui m'interrogent maintenant.
Il y en a quelques-uns qui sont déjà visiblement fatigués, mais la mort ne vient toujours pas.
Trois heures. La première clarté du matin arrive des faubourgs. Les marchands de légumes s'approchent du marché et les balayeurs entrent dans leurs rues. Peut-être vais-je même vivre assez pour voir encore une autre matinée.
On amène ma femme
—Vous le connaissez ?
J'avale mon sang pour qu'elle ne le voie pas... et c'est sûrement assez bête parce que le sang coule de chaque pore de ma figure et même du bout de mes doigts.
— Vous le connaissez ? — Je ne le connais pas.
Elle l'a dit et même aucun regard n'a trahi son horreur. Elle a respecté notre accord qu'elle n'avouera jamais me connaître, bien que cela soit maintenant inutile. Qui donc leur a dit mon nom ? On l'a emmenée, j'ai pris adieu d'elle avec le plus gai regard dont j'étais encore capable, peut-être n'était-il pas gai, je n'en sais rien.
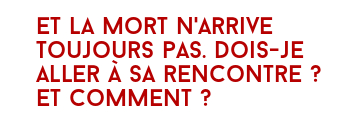 Quatre heures du matin. Commence-t-il à faire jour ou non, les fenêtres camouflées ne répondent pas. Et la mort n'arrive toujours pas. Dois-je aller à sa rencontre ? Et comment ?
Quatre heures du matin. Commence-t-il à faire jour ou non, les fenêtres camouflées ne répondent pas. Et la mort n'arrive toujours pas. Dois-je aller à sa rencontre ? Et comment ?
J'ai frappé quelqu'un et je suis tombé par terre, ils me donnent des coups de pied, ils marchent sur moi. Eh bien, maintenant, la fin sera rapide. Le commissaire noir me soulève par la barbe et il rit de contentement en me montrant ses mains pleines de poils arrachés. C'est vraiment comique. Et maintenant je ne sens déjà plus la douleur.
Cinq heures, six, sept, dix. Midi, les ouvriers sont partis au travail et l'ont quitté. Les enfants ont été à l'école et en sont revenus. On vend dans les boutiques, on prépare les repas dans les maisons, peut-être à ce moment ma mère se souvient-elle de moi, peut-être le camarades savent-ils déjà que j'ai été arrêté et prennent-ils peut-être des mesures de précaution...
Si je parlais quand même... Non, ne craignez rien, je ne parlerai pas, croyez-moi. C'est maintenant seulement un rêve, un cauchemar fiévreux, les coups tombent, après on me lave à l'eau et encore des coups et encore : « Parle ! Parle ! Parle ! » et encore des coups, je n'arrive pas à mourir. Mère, père, pourquoi m'avez-vous fait si fort ?
Cinq heures du soir. Tout le monde est déjà fatigué, les coups ne tombent plus maintenant que de temps en temps, à de long intervalles, ce n'est plus que la force d'inertie.
Et tout d'un coup, j'entends de loin, de très loin, une voix paisible, douce, tendre comme une caresse : — Er hat schon genug (Il en a déjà assez !)
Quelque temps après, je suis assis devant une table qui se lève et s'abaisse devant mes yeux, quelqu'un me donne à boire, quelqu'un me propose une cigarette, que je ne peux tenir et quelqu'un essaie de me mettre mes souliers et dit que ce n'est plus possible ; après on me conduit en me portant à moitié le long d'un escalier.
Nous descendons ; dans la voiture, nous roulons, quelqu'un braque de nouveau son pistolet sur moi, ça me fait rire, nous dépassons un tramway couronné de fleurs blanches, c'est le tramway des noces, mais peut-être tout cela n'est-il qu'un cauchemar ou bien seulement la fièvre, ou l'agonie, ou enfin même la mort.
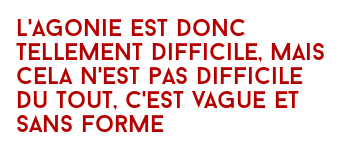 L'agonie est donc tellement difficile, mais cela n'est pas difficile du tout, c'est vague et sans forme, c'est léger comme un duvet, encore un souffle et tout sera terminé.
L'agonie est donc tellement difficile, mais cela n'est pas difficile du tout, c'est vague et sans forme, c'est léger comme un duvet, encore un souffle et tout sera terminé.
Vraiment tout ? Toujours ? Pas encore. En ce moment même je suis debout de nouveau, debout tout seul, vraiment debout, tout seul, sans l'appui de personne et près de moi s'allonge un mur d'un jaune sale, arrosé par quelque chose, par quoi ? il me semble que c'est du sang… oui, c'est du sang, je lève mon doigt et j'essaie de l'atteindre, je le touche, il est frais, c'est le mien...
Quelqu'un derrière moi me frappe sur la tête et m'ordonne de lever les mains et de faire des génuflexions, à la troisième je tombe..
Un grand SS est au-dessus de moi et me donne des coups de pied pour me forcer à me lever, mais c'est inutile ; quelqu'un me lave encore une fois. Je suis assis. Une femme quelconque me donne un médicament et me demande où j'ai mal, et il me semble que toute ma douleur est au cœur.
— Tu n'as pas de cœur, me dit le grand SS.
— J'en ai quand même, lui répondis-je.
Je suis tout d'un coup très fier, parce que j'ai été encore assez fort pour prendre la défense de mon cœur. Mais après, tout s'efface devant mes yeux, même le mur, même la femme au médicament, même le grand SS...
La porte d'une cellule est ouverte devant moi et un gros SS me traîne à l'intérieur, il retire les lambeaux de ma chemise, il me met sur une paillasse, il tâte mon corps gonflé et il ordonne qu'on me donne des compresses.
— Regardez, dit-il à son compagnon, et il hoche la tête, regardez bien ce qu'ils arrivent à faire.
Et encore une fois de loin, de très loin j'entends la voix paisible et douce, tendre comme une caresse : — Il ne verra pas le matin.
Dans cinq minutes les pendules vont sonner dix heures, c'est un beau soir frais de printemps, le 2 avril 1943 [soit un après : on vient de lui remettre clandestinement de quoi écrire].
