Le rôle néfaste de Jean Fréville au PCF pour les arts et les lettres
Submitted by Anonyme (non vérifié)Né en Ukraine en 1895, Eugène Schkaff a suivi sa famille fuyant la révolution russe de 1917 et il devint Jean Fréville, naturalisé français en 1927. La même année il décide de rejoindre le Parti Communiste - SFIC et assiste à Moscou au 10e anniversaire de la révolution.
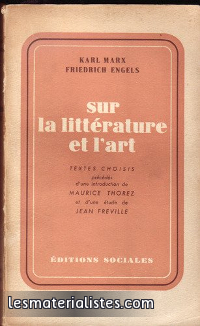
Il devient alors directement l'une des principales figures intellectuelles du Parti Communiste, écrivant dans l'Humanité en tant que chroniqueur littéraire hebdomadaire à partir de mars 1931 et publiant différents ouvrages au sujet du réalisme socialiste en URSS, comme Les Grands textes du marxisme sur la littérature et l'art publié en 1937 et L'art et la vie sociale — Plékhanov et les problèmes de l'art publié en 1949.
Dans ce dernier ouvrage, il précise sa vision des choses, dénaturant le réalisme socialiste en « esthétique militante », le dégradant au rôle d'orientation, sans jamais prendre en compte la théorie matérialiste dialectique du reflet.
Selon Jean Fréville, le réalisme socialiste est une sorte de romantisme qui deviendrait « objectif », c'est un subjectivisme tourné vers le bonheur et qui deviendrait objectif par le marxisme. C'est un idéalisme complet et on n'est guère étonné que le révisionnisme de Nikita Khrouchtchev ait triomphé si facilement dans les années 1950.
Jean Fréville dit notamment :
« Quand la vie sociale se transforme, les superstructures et les exigences esthétiques se modifient. L'impérialisme, l'interpénétration des cultures nationales, le progrès des sciences et des techniques – qu'on songe seulement à l'efficacité du cinéma et de la radio pour toucher et éduquer les masses, - les guerres et les révolutions ont agi sur les arts.
Les immenses bouleversements apportés par la Révolution russe ont déplacé les horizons, déchiré les anciens voiles, rendu impossibles les vieilles équivoques, arraché l'artiste à ses servitudes et aussi à ses réactions d'auto-défense : contemplation de son moi et mirage de la vie intérieure.
De nouveaux problèmes ont surgi, qui ne se posaient pas ou ne se posaient pas de la même façon du temps de Plékhanov : héritage culturel, contenu idéologique et signification de l'art, réalisme socialiste – méthode essentielle de l'art socialiste, où le réalisme éclaire un monde qui se transforme et où le romantisme révolutionnaire stimule, exalte, agrandit l'homme, lui inspire l'héroïsme, le pousse à se dépasser – importance grandissante de l'art dans une société maîtresse de ses destins… (…)
L'esthétique scientifique fondée sur le marxisme a balayé les mensonges de l'esthétique bourgeoise et son fameux principe de « l'art pour l'art » - digne pendant de la démocratie « pure » et de la politique « au-dessus des classes. » C'est elle qui oriente l'art soviétique et en fait un élément dynamique de la vie sociale.
Mais cette esthétique militante, devenue une science grâce au marxisme, ne nous a pas encore livré le mot de toutes les énigmes posées par l'art. Faut-il s'en étonner ?
Le marxisme n'est pas un dogme figé, c'est une science vivante, sans cesse enrichie par des apports nouveaux, et qui dépasse constamment ses positions antérieures.
Une esthétique marxiste ne saurait donc être un recueil de formules, un ensemble de canons et de règles rigides.
Étayée par le matérialisme historique, elle englobe l'évolution de tous les arts, ainsi que les multiples problèmes de la vie intellectuelle et de la création artistique. Elle se nourrit des plus récentes découvertes des sciences de la nature et de l'homme – et ces sciences, en particulier l'anthropologie, la paléontologie, l'ethnographie, la psychologie du travail, la psychotechnique, la biologie, ont beaucoup progressé au cours du XXe siècle.
Cette esthétique marxiste, qui donne à la littérature et à l'art une impulsion vigoureuse, est appelée à expliquer scientifiquement les ouvrages de l'esprit et les principes de la création intellectuelle ; à étudier les conditions qui font naître les œuvres d'art et à dire pourquoi celles-ci gardent une valeur durable, alors que les conditions qui les expliquent on disparu ; à reconstituer l'histoire véritable des civilisations, en rattachant à l'infrastructure économique et en reliant entre elles ce que ces civilisations ont produit de plus délicat et de plus achevé, d'unique et d'irremplaçable : leurs efflorescences artistiques.
Bien plus, comme la science qui lui fournit ses assisses, comme l'art dont elle fait son objet, elle est une création continue, toujours en mouvement, jamais terminée… Matériaux immenses, questions complexes, ardues, souvent encore obscures, travail passionnant et gigantesque... »
On a là un mélange de syndicalisme « révolutionnaire » et de volontarisme de nature « scientifique » dans l'esprit de René Descartes et du naturalisme d'Emile Zola.
 Il n'est guère étonnant que dans ce passage Jean Fréville parle du mystère que serait l'art et la « création » artistique : sa conception est idéaliste. Inversement pour le matérialisme dialectique l'art rest un reflet synthétique relevant d'une production.
Il n'est guère étonnant que dans ce passage Jean Fréville parle du mystère que serait l'art et la « création » artistique : sa conception est idéaliste. Inversement pour le matérialisme dialectique l'art rest un reflet synthétique relevant d'une production.
Le véritable point de vue de Jean Fréville, c'est celui de la « littérature prolétarienne » : une littérature pour les prolétaires, utilisant des techniques artistiques plus ou moins élevées. L'art n'est pas rattaché à une société, à sa culture en tant que progrès, en tant que démocratie, avec le reflet du rapport de cette société à la réalité générale, la nature comme l'univers.
Jean Fréville comprend le réalisme socialiste comme un simple rapport nouveau à l'art : à l'art pour l'art des bourgeois niant ou idéalisant la réalité, il faudrait opposer un art engagé parlant de la réalité sociale en prenant partie.
C'est à peu près la même vision que Victor Hugo ; cela n'a rien à voir avec le réalisme socialiste, et on est guère étonné qu'à ce titre il salue l'esprit petit-bourgeois « révolutionnaire » choisissant le bon camp.
Voici par exemple comment il salue le roman de Paul Nizan, Antoine Bloyé, dans l'Humanité du 18 décembre 1933 :
« Le régime capitaliste entraîne constamment le passage d'individus d'une classe dans une autre : il précipite des masses sans cesse renouvelées de petits producteurs, de petits propriétaires, de petits rentiers, expropriés et ruinés, dans le prolétariat ; c'est un processus normal de prolétarisation.

Mais en même temps, il permet à une mince couche du prolétariat, grâce aux miettes que distrait la bourgeoisie de ses surprofits et qu'elle lui jette, de constituer une aristocratie ouvrière.
Bien plus, la bourgeoisie ravira aux classes laborieuses les hommes dont elle aura remarqué les talents, elle les poussera à gravir tous les échelons hiérarchiques, elle en fera des professeurs et des présidents du conseil.
Ce renouvellement perpétuel, cette osmose sociale, ce flux constant des sèves ouvrières et paysannes qui fait reverdir le tronc racorni de la classe possédante, c'est ce qui donne sa foce et sa santé à la bourgeoisie.
Réduite à ses seules ressources, elle s'anémierait rapidement, elle s’étiolerait, elle s'éteindrait au fond de ses chambres capitonnées, dans cette atmosphère fin de classe qu'ont si bien rendue Barrès et Proust (…).
Tant que subsistera le régime, il y aura des Antoine Bloyé. Le récit de leurs malheurs n'effraiera parsonne.
A la masse ouvrière inconsciente, noyée dans son malheur quotidien, l'existence assurée, confortable d'un Antoine Bloyé continuera d'apparaître comme un sort digne d'envie. Comme ils sont plus légers que ceux des ouvriers, les fardeaux d'Antoine Bloyé ! Que pèsent ses angoisses séniles, ses remords, à côté de la misère prolétarienne, des humiliations subies, des brutalités du contre-coup, de la férocité des patrons, de l'insécurité du lendemain, du chômage, avec la faim et le froid pour cortège ?
Pour refuser de parvenir, pour rester, malgré les possibilités de carrière et d'avancement, fidèle à la classe ouvrière, - notre camarade Nizan le sait mieux que quiconque, lui qui vit parmi eux, - il faut la conviction et la flamme ardente des révolutionnaires.
Antoine Bloyé est le récit d'une vie manquée, thème qu'affectionnent les écrivains de la bourgeoisie, de Flaubert à Tchékhov, de Dickens à Duhamel.
Nous aurions aimé qu'en face de cette vie manquée notre camarade Nizan eût campé un ouvrier révolutionnaire, heureux de lutter pour sa classe, - par exemple le chauffeur révoqué qu'Antoine rencontre après une grève…
[Le roman] Antoine Bloyé constitue néanmoins une tentative saine, digne d'être notée. Nizan a le mérite de poser un problème social dans son ampleur, de montrer, de manière saisissante, le néant de la vie des petits bourgeois.
Face aux écrivains qui décrivent un prolétariat passif et résigné, il s'élève contre les déserteurs de la lutte de classe.
Nous voulons plus encore. De ceux dont on attend beaucoup, on exige beaucoup. Notre camarade Nizan est de ce nombre. Il est l'un des dirigeants de l'Association des Ecrivains et Artistes révolutionnaires, il appartient à ce noyau de militants qui combattent en France pour une littérature prolétarienne où s'exprimeraient les aspirations spontanées des masses que notre Parti traduit dans sa lutte quotidienne.
Son livre est une étape. Nous sommes certains que dans ses œuvres prochaines il dira l'immense bouillonnement révolutionnaire de l'époque, et que l'écrivain chez lui saura profiter des leçons du militant. »
On a ici une définition fort juste du thorézisme : « les aspirations spontanées des masses que notre Parti traduit dans sa lutte quotidienne », car Maurice Thorez représente un syndicalisme révolutionnaire considérant qu'il faut un « parti ».
 Il est tout à fait logique alors que Jean Fréville parle de « littérature prolétarienne », expression normalement employée uniquement par les syndicalistes révolutionnaires : entre ces derniers et le PCF, la différence tient non pas tant au fond idéologique et culturel qu' à la question de savoir s'il faut un « noyau » organisé ou pas pour épauler le syndicat.
Il est tout à fait logique alors que Jean Fréville parle de « littérature prolétarienne », expression normalement employée uniquement par les syndicalistes révolutionnaires : entre ces derniers et le PCF, la différence tient non pas tant au fond idéologique et culturel qu' à la question de savoir s'il faut un « noyau » organisé ou pas pour épauler le syndicat.
La littérature est ainsi forcement « prolétarienne », « spontanée » comme chez les syndicalistes révolutionnaires, mais il faut un « militantisme » pour renforcer le « spontanéisme », « spontanéisme » que normalement le matérialisme dialectique rejette.
Il y a pire ici cependant : Jean Fréville fait l'apologie de la figure du petit-bourgeois oscillant, échouant, acceptant son sort prolétarien afin de « s'élever ». C'est une position carriériste, et d'ailleurs Paul Nizan, anciennement proche de l'extrême-droite, trahira le Parti Communiste en 1939.
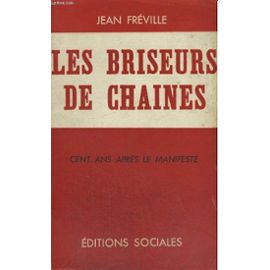 Jean Fréville salue même la capacité de Marcel Proust et Maurice Barrès à représenter une « atmosphère fin de classe » - c'est là une mentalité de dandy, considérant, comme le fascisme le fait, que la bourgeoisie a « fait son temps », mais sans compréhension aucune de ce qu'est le communisme.
Jean Fréville salue même la capacité de Marcel Proust et Maurice Barrès à représenter une « atmosphère fin de classe » - c'est là une mentalité de dandy, considérant, comme le fascisme le fait, que la bourgeoisie a « fait son temps », mais sans compréhension aucune de ce qu'est le communisme.
Il y aura encore pire par ailleurs : dans la revue Commune de mars-avril 1934, Louis Aragon fait même du roman Antoine Bloyé une œuvre « réaliste socialiste » !
Tout cela révèle qu'on a ici un point de vue petit-bourgeois, comprenant que la bourgeoisie a fait son temps, mais ne comprenant rien au matérialisme dialectique et cherchant donc à remplacer subjectivement la bourgeoisie par un « projet ».
La seule différence avec la petite-bourgeoisie fasciste est, qu'ici, Jean Fréville appelle à soutenir socialement les masses populaires. Voici comment Jean Fréville appelle à une littérature prolétarienne, dans l'Humanité du 27 novembre 1933 :
« La littérature est une arme de classe, avons-nous répété bien souvent. Le roman [Quand les Sirènes se taisent]de Van der Meersch, porte-parole du Consortium, nous en fournit une preuve nouvelle. Les exploits les plus hardis de la classe ouvrière, ses souffrances et ses victoires y sont salis, défigurés, utilisés contre elle.
Cela, c'est la tâche des écrivains bourgeois. Un Van der Meersch qui l'accomplit est dans son rôle.
Quand donc les écrivains révolutionnaires, les écrivains prolétariens exalteront-ils la force et l'héroïsme ouvriers, quand donneront-ils enfin des œuvres dignes de la classe ouvrière ?
Pour le moment, en France, nous n'en pouvons, hélas ! citer aucune. »
C'est révélateur de la ligne générale du Parti Communiste, qui se voit comme une avant-garde pratique d'un syndicalisme révolutionnaire allant jusqu'au bout.
Jean Fréville sera d'ailleurs très lié à Maurice Thorez ; dans l'ouvrage Fils du peuple que ce dernier aurait écrit, on peut lire à un moment :
« Ferrailles rongées et verdies, informes lacis, larges entonnoirs aux escarpements crayeux, ravinés, immenses tranchées creusées en labyrinthes, infranchissables vallonnements, ravagés... »
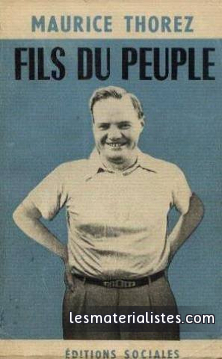 Or, si l'on s'attarde sur la première lettre de chaque mot et qu'on les relie, on obtient « Fréville a écrit ce livre ».
Or, si l'on s'attarde sur la première lettre de chaque mot et qu'on les relie, on obtient « Fréville a écrit ce livre ».
Jean Fréville agira tout au long de la carrière de Maurice Thorez, prenant notamment la parole au congrès international des écrivains pour la défense de la culture, dans le cadre de la lutte antifasciste.
Son souci démocratique s'avérait donc contre-productif de par les limites du thorézisme.
Et Jean Fréville joua un rôle clef dans la non-compréhension du réalisme socialiste en sabotant les explications soviétiques à ce sujet, n'ayant en vue qu'une littérature engagée, tournée vers le peuple, dans une incompréhension ainsi totale de la théorie du reflet et du réalisme socialiste comme synthèse artistique produite rationnellement par une société à une époque donnée, et non créée par un artiste considéré individuellement.
