Le Parti Communiste français - 9e partie : L’ancrage dans la république
Submitted by Anonyme (non vérifié)1. La « déstalinisation »
Le développement du courant trotskyste est un phénomène nouveau et totalement marginal par rapport au poids électoral et militant du PCF, mais s’appuyant sur tout un faisceau de courants idéologiques. La caractéristique essentielle du PCF était le monolithisme, or avec le 20ème congrès du Parti Communiste d’Union Soviétique en 1956, ce monolithisme explose avec le « rapport secret » de Nikita Khrouchtchev.
 Ce document a été « secret » dans la mesure où il n’a jamais été publié officiellement en URSS. Le congrès s’est tenu du 14 au 24 février et c’est le soir du 24, le congrès une fois terminé, que Khrouchtchev lit le document Sur le culte de la personnalité et ses conséquences. Il s’agit en fait de l’annonce de ce qui est communément appelé dans les manuels d’histoire la « déstalinisation ».
Ce document a été « secret » dans la mesure où il n’a jamais été publié officiellement en URSS. Le congrès s’est tenu du 14 au 24 février et c’est le soir du 24, le congrès une fois terminé, que Khrouchtchev lit le document Sur le culte de la personnalité et ses conséquences. Il s’agit en fait de l’annonce de ce qui est communément appelé dans les manuels d’histoire la « déstalinisation ».
Ce « rapport secret » a énormément gêné le Parti Communiste Français. Non pas parce que le contenu lui imposait une remise en question stratégique : le PCF avait de par ses conceptions largement anticipé les thèmes du « rapport secret », principalement la « voie pacifique au socialisme ».
Il n’y aura pour preuve quasiment aucune scission dans les rangs du PCF lui-même ; il n’y aura de même qu’une seule figure dirigeante marquante restant fidèle à Staline, Gilbert Mury. Il n’y a pas de remises en question avec la « déstalinisaton » et Maurice Thorez lui même participera avec Nikita Khrouchtchev et d’autres à la critique de Mao Zedong et du Parti Communiste de Chine, qui refusent de ne plus considérer Staline comme un « classique ».
Mais le problème était justement là. La nouvelle interprétation que pose Nikita Khrouchtchev est en fait déjà celle qu’a le PCF. Il n’y a donc pas de rupture, mais paradoxalement la remise en cause de la figure de Staline est censée amener avec elle celle des conceptions dominantes alors. Or, Maurice Thorez avait présenté sa conception comme une adaptation française de l’interprétation par Staline du marxisme-léninisme. Maurice Thorez se pose dans la continuité de l’oeuvre commencée dans les années 1930. C’est un aspect essentiel et quasiment unique.
Cela a signifié énormément de problèmes à court terme pour le PCF, parce que celui-ci a dû adapter sa conception au nouveau discours dominant en URSS, alors que dans les autres pays le chamboulement complet pouvait être plus net, marquant une vraie rupture au niveau des idées. Inversement, dans le PCF, il n’y avait pas de possibilité de réelle rupture, ce qui explique non seulement l’absence de crise, mais aussi la plus longue continuité temporelle par rapport aux partis communistes d’autres pays, dans la mesure où la cohérence reposait sur un socle beaucoup plus ancien, une pratique populaire et culturelle plus ancrée.
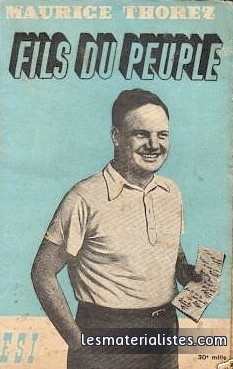 Dans certains pays les Partis Communistes ne se sont jamais remis de la « déstalinisation », malgré leur prestige et leur organisation au lendemain de la guerre, comme en Autriche. Et pareillement, après la chute du mur, certains partis pour qui la « déstalinisation » a été un chamboulement complet mais qui ont réussi à se maintenir se sont effondrés avec la disparition de l’URSS, comme le Parti Communiste italien, pourtant aussi puissant historiquement que le PCF.
Dans certains pays les Partis Communistes ne se sont jamais remis de la « déstalinisation », malgré leur prestige et leur organisation au lendemain de la guerre, comme en Autriche. Et pareillement, après la chute du mur, certains partis pour qui la « déstalinisation » a été un chamboulement complet mais qui ont réussi à se maintenir se sont effondrés avec la disparition de l’URSS, comme le Parti Communiste italien, pourtant aussi puissant historiquement que le PCF.
Ces faits restent totalement incompris des historiens « universitaires », qui expliquent que Maurice Thorez était un « stalinien » puis que quelques années après il a changé de position, pratiquant un « service minimum » dans la « déstalinisation », cela alors que le PCF a été au premier rang avec le Parti Communiste d’Union Soviétique pour critiquer Mao Zedong et le Parti Communiste de Chine.
Maurice Thorez explique donc ainsi le rapport secret devant le Comité central du PCF, le 9 mai 1956 :
« Le rapport de Khrouchtchev sur la critique du culte de la personnalité a été donné hors de la présence des délégués des partis frères. Par exception, avec des délégués du Parti communiste chinois et ceux des partis des démocraties populaires, nous avons eu la possibilité de lire le rapport, nous en avons extrait tout le contenu politique, qui a été rapporté au Bureau politique par le secrétaire général et devant le Comité central par Jacques Duclos. Mais je dois dire que nous n’étions pas autorisés à divulguer le texte de ce rapport, encore moins à le publier, nous ne l’avions pas en main : dès que nous avons terminé notre lecture, nous l’avons rendu (...).
Des camarades qui ont eu aussi à lire le rapport ont été autorisés à prendre des notes. Ou même à l’emporter et à le faire lire, ou à le publier presque. C’est une chose qui ne nous a pas été permise. D’ailleurs je dois dire qu’à notre avis ça n’était pas indispensable (...). Je dis ces choses d’abord pour que le Comité central sache que rien ne lui a été caché, que d’ailleurs nous n’avions rien à cacher (...). Ce que nous n’avons pas dit, c’est que nous ne savons pas. Et pour la partie des choses que je dis maintenant ici au Comité central, que nous n’estimions pas nécessaire de répéter, nous considérions que c’étaient là des secrets, des secrets d’État et les secrets du Parti, d’un parti au pouvoir.
Ça n’était pas à nous à aller au devant, sous prétexte que la presse bourgeoise commençait la campagne et sous prétexte, je le dis en toute franchise, sous prétexte que d’autres avaient eu moins de discrétion que nous (...). La méthode était critiquable. À la délégation nous l’avons pensé immédiatement, et nous avons émis des réserves immédiatement auprès du camarade Khrouchtchev - je dis ceci pour le Comité central seulement.
Je crois que la méthode a été critiquable parce qu’il s’avère maintenant que - pas seulement en URSS - le rapport courait pour ainsi dire les rues, que des militants qui partent de chez nous dans d’autres pays - il est vrai des pays de démocratie populaire - pouvaient avoir connaissance du rapport. Même maintenant des gens qui ne sont pas membres du Parti peuvent presque lire le rapport quand ils se rendent en Pologne. En tout cas nous ne voulons pas nous rendre coupables de telles fautes au regard de la discrétion que nous devons avoir sur ces questions et de nos engagements vis-à-vis du Parti communiste de l’URSS (...).
Ce que nous avions à dire sur cette méthode, nous l’avons exposé au camarade Khrouchtchev. Je rappelle ce qu’on disait tout à l’heure, Jeannette disait : « Une des différences entre nous et là-bas, c’est que là-bas il n’y a pas le feu immédiat de l’ennemi. Il n’y a pas la presse, il n’y a pas tout de suite tous les bombardements de la presse ennemie. On peut se permettre d’attendre et de poser des questions en son heure », etc. Nous, nous savions bien que dès la première publication ce serait un bombardement acharné, pas contre nous, contre l’URSS, contre le Parti d’URSS, contre tout ce à quoi nous sommes les uns et les autres attachés, les idées du communisme (...).
Dans ce rapport où il est question de la critique de la personnalité, il est rendu à différentes reprises hommage à Staline : on montre les mérites de Staline, ce qu’il a apporté au Parti. C’est dans ce rapport que nous avons pris pour le Comité central comme pour mon article l’appréciation positive du rôle de Staline. Aussi les critiques. J’ai dit en notre nom à Khrouchtchev : « Pourquoi dans vos rapports publics et dans les interventions publiques des différents camarades, n’y a-t-il eu que des côtés négatifs et pas un seul de ces éléments positifs que vous avez donnés dans ce rapport secret ? Vous eussiez beaucoup facilité la tâche des communistes dans les autres pays... » »
 Telle est la ligne de Maurice Thorez : ne pas critiquer Staline totalement aurait aidé la « déstalinisation » dans les autres pays – et notamment la France. Il ne s’agit aucunement d’une remise en cause de la dite « déstalinisation ».
Telle est la ligne de Maurice Thorez : ne pas critiquer Staline totalement aurait aidé la « déstalinisation » dans les autres pays – et notamment la France. Il ne s’agit aucunement d’une remise en cause de la dite « déstalinisation ».
Mais pour temporiser, le PCF n’attaque pas directement Staline et lance toute une série de documents fondés sur la théorie du « ce n’est pas si simple », comme le résume l’Humanité du 12 mai 1956 : « Tout cela n’est pas simple, rectiligne. Au moment même, Staline lui-même nous donnait un ouvrage sur la linguistique qui reste une base très utile, nécessaire, d’explication de notre théorie du matérialisme dialectique... » La question ne se pose pas ainsi de toutes manières pour le PCF, puisque celui qui compte, c’est celui qui est appelé « le meilleur d’entre nous » dans les organes de presse. Les anniversaires de Maurice Thorez sont fêtés, les cellules lui offrent des cadeaux, allant de peintures à des bibelots, des mouchoirs cousus aux affiches. Les Œuvres complètes de Maurice Thorez sont publiées par les Éditions sociales, entre 1950 et 1960, en 21 tomes. Son ouvrage, Fils du peuple, publié en 1937, est réédité dans une version de 1947 puis plusieurs fois réédité. L’ouvrage commence par la phrase : « Fils et petit-fils de mineurs, aussi loin que remontent mes souvenirs, je retrouve la rude vie du travailleur : beaucoup de peines et peu de joies. »
Le XIVème congrès du PCF, qui se tient du 18 au 21 juillet 1956 au Havre, se déroule ainsi dans la continuité des thèses passées, comme le montre le mot d’ordre : « Pour un avenir de progrès social, de paix et de grandeur nationale ». Le XXème congrès du Parti Communiste d’Union Soviétique y est présenté comme « l’événement le plus important du mouvement ouvrier dans la dernière période ».
Le PCF propose un programme précis, avec notamment le développement de l’industrie de la machine-outil, de l’aéronautique et de l’électronique, la formation d’ingénieurs et de techniciens, le développement des universités et de la recherche scientifique... Et un appel à un travail étroit avec les socialistes est lancé :
« Nous savons bien que beaucoup de choses nous séparent encore. Celles qui nous unissent sont pourtant beaucoup plus grandes. La nécessité et la possibilité d’union ressortent du but même que nous nous sommes fixés les uns et les autres : l’avènement du socialisme. Elles surgissent constamment du combat permanent que nous avons à mener contre les forces réactionnaires.
C’est un appel à l’union du Parti Communiste et du Parti socialiste qui monte des usines, des mines, des chantiers, des magasins, des bureaux, des champs, des universités. C’est le testament de nos grands et glorieux disparus dans les luttes ouvrières, dans les combats de la Résistance et de la Libération. C’est la demande expresse de notre jeunesse, de nos enfants qui, grâce à notre union, pourront grandir dans la société dont rêvaient les pionniers du socialisme. »
 La vague de la « déstalinisation » est puissante, elle bouleverse les pays de l’Est européen et en Hongrie a ainsi lieu une véritable insurrection anti-communiste en octobre 1956, qui est écrasée par le gouvernement aidé par l’URSS. Les soutiens français de l’insurrection passent à l’action, d’autant plus que la campagne militaire de Suez menée par l’État français a été un échec et a été combattu par le PCF.
La vague de la « déstalinisation » est puissante, elle bouleverse les pays de l’Est européen et en Hongrie a ainsi lieu une véritable insurrection anti-communiste en octobre 1956, qui est écrasée par le gouvernement aidé par l’URSS. Les soutiens français de l’insurrection passent à l’action, d’autant plus que la campagne militaire de Suez menée par l’État français a été un échec et a été combattu par le PCF.
Les attaques et attentats contre les locaux et les militants du PCF et de syndicats se multiplient ; ainsi l’imprimerie niçoise du Patriote est attaquée, le siège de l’Union Départementale CGT à Chartres est incendié, le siège du Comité Central et l’immeuble de l’Humanité sont attaqués également.
Les dirigeants des syndicats FO, CFTC et CGC appellent à cesser le travail le 7 novembre à 17 heures ainsi qu’à une manifestation ; l’Eglise, la radio et la presse soutiennent le mouvement. La manifestation anticommuniste, alors que le meeting au Vélodrome d’Hiver pour le 39ème anniversaire de la Révolution d’Octobre est interdit, se transforme en cortège pour attaquer le siège du Comité Central.
Les manifestants sont rejoints par des parachutistes en uniforme et sont armés lorsqu’ils arrivent et que les policiers encerclant les locaux les laissent passer ; ils disposent également de béliers, d’échelles, de jerricans d’essence. Les militants de garde font qu’ils ne passeront pas le premier étage, alors que les manifestants attaquent ensuite l’imprimerie de l’Humanité en scandant « Le feu à l’Huma ! Grillons les communistes ! A l’assaut ! »
Des contre-manifestants, venus des quartiers populaires parisiens et de banlieue, sauvent alors la mise, mais au prix de nombreux blessés et de trois morts. Des accrochages ont également eu lieu dans divers coin du pays. Le lendemain, aucun journal ne paraît et des centaines de débrayages ont lieu, alors que des manifestations ont lieu à Marseille, Lyon, Bordeaux, Amiens, Strasbourg... Et également à Paris où 50 000 travailleurs défilent aux cris de « Le fascisme ne passera pas », malgré l’interdiction. L’Humanité-Dimanche est également diffusée trois jours après malgré les menaces fascistes et une grande mobilisation a lieu pour réparer les locaux.
 La tension remonte en 1958, avec l’activité de nombreux commandos fascistes et des attentats, notamment en rapport avec la question de l’Algérie française. Le PCF se pose comme défenseur des institutions : « Le complot d’Alger s’affirme au grand jour comme un complot gaulliste préparé de longue date... Il faut donc écraser la rébellion et châtier les organisations de la guerre civile. Le Parti communiste français réaffirme solennellement qu’il ne saurait y avoir, dans la bataille engagée, d’autres buts pour la classe ouvrière que de défendre la légalité républicaine et de sauvegarder les institutions démocratiques et constitutionnelles. » (Déclaration du 18 mai 1958).
La tension remonte en 1958, avec l’activité de nombreux commandos fascistes et des attentats, notamment en rapport avec la question de l’Algérie française. Le PCF se pose comme défenseur des institutions : « Le complot d’Alger s’affirme au grand jour comme un complot gaulliste préparé de longue date... Il faut donc écraser la rébellion et châtier les organisations de la guerre civile. Le Parti communiste français réaffirme solennellement qu’il ne saurait y avoir, dans la bataille engagée, d’autres buts pour la classe ouvrière que de défendre la légalité républicaine et de sauvegarder les institutions démocratiques et constitutionnelles. » (Déclaration du 18 mai 1958).
L’appel à la mobilisation est même lancée : « Préparez-vous à exprimer votre puissance par une grève générale si les factieux poursuivent leur assaut ! » (Déclaration du Bureau Politique du 24 mai 1958). Mais le PCF, qui comptait sur les socialistes dont le groupe parlementaire et le comité directeur avaient déclaré dans Le Populaire du 28 mai 1958 « qu’ils ne se rallieront en aucun cas à la candidature du général De Gaulle qui, dans la forme même où elle est posée et par les considérants qui l’accompagnent, est et restera en toute hypothèse un défi à la légalité républicaine », est mis de côté par ceux-ci et De Gaulle reprend les rênes du pouvoir, apparaissant comme « le seul recours ».
L’arrivée de De Gaulle balaie les institutions, lui-même déclare lors d’une conférence de presse, le 23 octobre 1958, que « Si donc, il devait, par malheur, arriver que le Parlement de demain ne voulût pas s’accommoder du rôle qui lui est dévolu, il n’y a pas de doute que la République serait jetée dans une crise nouvelle dont personne ne peut prévoir ce qui en sortirait, excepté ceci, qu’en tout cas, l’institution parlementaire serait balayée pour longtemps. »
De Gaulle a le champ libre pour modifier les institutions et c’est la naissance de la Vème république acceptée par référendum à plus de 80% des voix le 28 septembre 1958. C’est une très lourde défaite pour le PCF qui avait appelé à voter non, seul dans ce cas avec le Parti Socialiste Unifié (PSU) sorti des rangs des socialistes, favorables à la nouvelle constitution.
Aux élections le PCF reste le premier parti avec presque 4 millions de voix, les socialistes en ayant un peu plus de 3 millions et les gaullistes 3,6 millions, mais avec le découpage des circonscriptions, il y a un élu communiste pour 388 220 voix, alors qu’il y a un élu gaulliste pour 19 169 voix.
Des modifications électorales sont également menées pour affaiblir les communistes pour les municipales, mais le PCF se maintient et arrive même à former des listes d’union « pour barrer la route aux hommes de la réaction et du fascisme » avec des socialistes et des républicains. Puis, l’opposition à De Gaulle progresse lors du référendum sur les institutions en Algérie, ainsi que lors des tensions en 1960 et surtout en 1961, lors du coup de force militaire à Alger, où 12 millions de travailleurs se mettent en grève avec formation de comités antifascistes, et où le PCF participe de plain pied. Le PCF se remet en avant comme figure institutionnelle seule capable d’empêcher le fascisme.
2. La démocratie comme « création continue »
 Le PCF, fort de ces différentes mobilisations populaires contre le gaullisme et contre les tentatives de débordement par la droite de celui-ci, va alors accentuer certains aspects de sa conception « démocratique » afin de s’ancrer davantage dans la vie politique. Lors du XVème congrès du PCF à Ivry, en banlieue parisienne, du 24 au 28 juin 1959, Maurice Thorez présente un rapport intitulé « L’union des forces ouvrières et républicaines pour la restauration et la rénovation de la démocratie » ; la thèse, somme toute assez simple, est que De Gaulle est l’homme des monopoles et des banques.
Le PCF, fort de ces différentes mobilisations populaires contre le gaullisme et contre les tentatives de débordement par la droite de celui-ci, va alors accentuer certains aspects de sa conception « démocratique » afin de s’ancrer davantage dans la vie politique. Lors du XVème congrès du PCF à Ivry, en banlieue parisienne, du 24 au 28 juin 1959, Maurice Thorez présente un rapport intitulé « L’union des forces ouvrières et républicaines pour la restauration et la rénovation de la démocratie » ; la thèse, somme toute assez simple, est que De Gaulle est l’homme des monopoles et des banques.
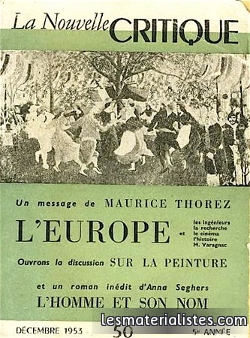 Le mot d’ordre du congrès est par conséquent : « A tout prix, front unique de la classe ouvrière, à tout prix, rassemblement de la classe ouvrière et des classes moyennes ». Il ressort également un Projet de programme de rénovation des institutions républicaines et de la vie nationale, avec comme idée de base la démocratie : il faut une assemblée nationale unique dont les élus sont choisis directement à la proportionnelle, avec un gouvernement émanant directement d’elle.
Le mot d’ordre du congrès est par conséquent : « A tout prix, front unique de la classe ouvrière, à tout prix, rassemblement de la classe ouvrière et des classes moyennes ». Il ressort également un Projet de programme de rénovation des institutions républicaines et de la vie nationale, avec comme idée de base la démocratie : il faut une assemblée nationale unique dont les élus sont choisis directement à la proportionnelle, avec un gouvernement émanant directement d’elle.
A cela s’ajoute des revendications sociales concernant le pouvoir d’achat, la semaine de 40 heures, une fiscalité pour « faire payer les riches », la fixation des prix de base, le développement des couches sociales formées par les ingénieurs, les techniciens, les spécialistes, la nationalisation des monopoles, des banques et des assurances...
Dans ce contexte de crise, le PCF trouve alors la clef de sa nouvelle identité : la mobilisation des masses pour la démocratie ; une idée qui va être au coeur de ses programmes jusqu’au 21ème siècle. C’est la conception synthétisée par Maurice Thorez dans son rapport d’activité du Comité central : « La démocratie, création continue, s’achèvera dans le socialisme. »
Maurice Thorez résume ainsi cette thèse centrale, dans son rapport d’activité du Comité central au congrès :
« En restreignant la mainmise des monopoles sur les forces productives et les richesses, en défendant ainsi non seulement ses intérêts propres, mais ceux de la paysannerie, des intellectuels, des classes moyennes mobilisées contre l’oppression du grand capital, la classe ouvrière s’affirme toujours plus capable d’assumer la charge du patrimoine matériel et spirituel de la France.
Elle gagne dans les couches de la petite bourgeoisie des alliés et des amis pour aborder des développements nouveaux de la vie politique. Elle montre aux travailleurs non-prolétariens que leur avenir et l’avenir de leurs enfants réside aussi dans le socialisme, que l’épanouissement de l’économie nationale, la grandeur et le bonheur du pays sont liés à l’établissement de relations sociales supérieures. Il n’y a plus à notre époque de long intervalle historique entre les transformations démocratiques et les transformations socialistes. La direction de la lutte politique du peuple par la classe ouvrière, si manifeste de nos jours, rapproche et soude entre elles les deux étapes. La démocratie, création continue, s’achèvera dans le socialisme. »
C’est une véritable vision générale du monde qui naît, une conception autant philosophique que politique, comme en témoigne le point 30 des thèses du congrès : « L’instauration du socialisme, c’est-à-dire la transformation de la société par le passage des rapports de production fondés sur la propriété privée des moyens de production et d’échange à des rapports fondés sur la propriété sociale de ces moyens, ne peut être réalisée que par des millions d’hommes luttant au grand jour, fondant leur action sur leur propre expérience et sur leur volonté propre de résoudre les problèmes vitaux posés à la nation. Contrairement aux calomnies anticommunistes, l’instauration du socialisme ne peut pas être le fait d’une faction s’organisant dans l’ombre, la conséquence d’un complot ou le résultat d’une intervention extérieure faisant violence à la majorité du peuple.
Le Parti communiste a toujours fait sienne cette thèse de Lénine : « développer la démocratie jusqu’au bout, rechercher les formes de ce développement, les mettre à l’épreuve de la pratique, c’est là une des tâches essentielles de la lutte pour la révolution sociale. Pris à part, aucun démocratisme ne donnera le socialisme, mais, dans la vie, le démocratisme ne sera jamais « pris à part », il sera « pris dans l’ensemble », il exercera son influence sur l’économie également, il en stimulera la transformation et, à son tour, il subira l’influence du développement économique, etc.Telle est la dialectique vivante de l’histoire. »
La lutte pour le socialisme se situe donc dans les perspectives de la lutte pour la démocratie et son progrès continu, de la lutte pour donner une réponse concrète aux grandes questions que les événements posent à la France. »
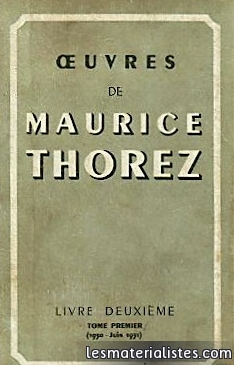
Il va de soi que cette position est à rapprocher de celle de Jean Jaurès, pour qui « Le socialisme se rattache à la tradition historique de la démocratie. Il va vers un ordre nouveau sans rompre la profonde continuité républicaine ; et il touche, dans le combat, au sol même de la République » (Le socialisme français, Cosmopolis, revue internationale, 25 janvier 1898).
Et voilà pourquoi la « démocratie véritable » est encore un concept central du congrès suivant, le seizième, qui se tient à Saint-Denis du 11 au 14 mai 1961, sous le mot d’ordre : « Écarter tout ce qui divise, ne tenir compte que de ce qui unit », et dont le rapport s’intitule L’union de toutes les forces ouvrières et démocratiques contre le pouvoir des monopoles capitalistes, pour le progrès, la liberté, la paix, la restauration et la rénovation de la démocratie.
La résolution du congrès est explicite en ce qui concerne le rôle du PCF comme une sorte de barrière progressiste (et patriotique) aux tendances autoritaires : « Le grand capital monopoliste dont la nature est tout imprégnée de cosmopolitisme ne saurait avoir des préoccupations nationales authentiques... Le pouvoir gaulliste exprime donc les vues et la politique du capital monopoliste. Il porte en lui, en permanence, la menace du fascisme.Voilà ce qu’il importe de ne jamais perdre de vue, sous peine de désorienter dangereusement la lutte des forces ouvrières, démocratiques et nationales. »
Et de la même manière, la seule solution est l’union permise par la stratégie du PCF : « Le pouvoir des monopoles frappe les couches les plus nombreuses de la population française : la classe ouvrière, la paysannerie laborieuse, les couches moyennes des villes, certaines fractions de la bourgeoisie. C’est l’union de toutes ces couches qui permettra de vaincre le pouvoir personnel. Le chemin de la victoire passe obligatoirement par cette union... Le Parti communiste considère comme son devoir de surmonter tous les obstacles à l’union. » Cela signifie une union au sommet commençant par la base, qui donne « à la démocratie une perspective réelle, en lui traçant des voies pratiques. » (Maurice Thorez, Discours de clôture du XVIème congrès).
Ce principe est repris au congrès suivant, du 14 au 17 mai 1964 à Paris, dont le rapport a le titre révélateur de Pour assurer l’établissement d’une véritable démocratie et mettre fin au pouvoir personnel. Waldeck Rochet y réaffirme le même principe : « une telle unification suppose l’accord entre socialistes et communistes et, tant que les conditions ne sont pas réalisées, nous sommes pour la coopération étroite et durable », tout comme Maurice Thorez qui résume ce congrès en disant qu’il « a été un appel passionné à l’unité de la classe ouvrière et à l’union des forces démocratiques, au rassemblement des couches sociales victimes de la politique des monopoles, en vue de la lutte contre le pouvoir personnel, pour l’instauration d’une démocratie véritable (...).
« une telle unification suppose l’accord entre socialistes et communistes et, tant que les conditions ne sont pas réalisées, nous sommes pour la coopération étroite et durable », tout comme Maurice Thorez qui résume ce congrès en disant qu’il « a été un appel passionné à l’unité de la classe ouvrière et à l’union des forces démocratiques, au rassemblement des couches sociales victimes de la politique des monopoles, en vue de la lutte contre le pouvoir personnel, pour l’instauration d’une démocratie véritable (...).
A travers toutes ces actions, on retrouve l’idée et l’ébauche d’une plate-forme d’entente, un programme commun. Un projet de programme a été formulé par nous dès 1959, dans le but de donner une base concrète à l’alliance de la classe ouvrière, de la paysannerie laborieuse, des classes moyennes et de toutes les victimes des monopoles. Nous constatons que d’ores et déjà, bien des éléments communs existent dans les programmes des divers partis démocratiques : ne peut-on dégager à partir de là une conception qui réalise l’accord de tous ?
Si l’on veut communiquer aux forces démocratiques la confiance et l’élan indispensables pour créer les conditions de leur victoire, l’élaboration commune d’un programme commun s’impose. Au contraire, l’absence d’un tel programme permet au pouvoir de spéculer sur la crainte d’un « retour au passé » et de représenter les forces ouvrières et républicaines comme incapables de s’entendre pour faire oeuvre positive et neuve. »
(Discours de clôture du XVIIème congrès)
 C’est le dernier congrès de Maurice Thorez, qui meurt le 11 juillet 1964, laissant une place immense dans le PCF. L’histoire du PCF et celle de Maurice Thorez se sont confondues non seulement pendant plus de trente années, mais également durant les périodes qui ont forgé l’identité de l’organisation : la crise de 1930, le front populaire, la Résistance.
C’est le dernier congrès de Maurice Thorez, qui meurt le 11 juillet 1964, laissant une place immense dans le PCF. L’histoire du PCF et celle de Maurice Thorez se sont confondues non seulement pendant plus de trente années, mais également durant les périodes qui ont forgé l’identité de l’organisation : la crise de 1930, le front populaire, la Résistance.
Voilà pourquoi a inévitablement lieu une réunion pour aider au « passage » à un PCF qui doit suivre la ligne de Maurice Thorez sans celui-ci. Un passage qui en soi n’est pas excessivement difficile : Maurice Thorez était sérieusement malade depuis plusieurs années, et le groupe le concurrençant avait été liquidé en 1961 avec ce qui a été appelé « l’affaire Servin-Casanova ».
Laurent Casanova et Marcel Servin avaient été accusés de chercher à se poser comme une direction et exclus de toutes responsabilités à haut niveau ; Maurice Kriegel-Valrimont qui les soutenait avait lui été exclu du PCF. Tous les trois appuyaient la « déstalinisation », mais doutaient de l’alignement de De Gaulle sur les USA. De manière intéressante à noter, Casanova avait proposé en février 1949 la notion de « science prolétarienne », thèse rejetée par l’ensemble du mouvement communiste international et par le PCF lors d’une réunion d’intellectuels à Ivry, dont les travaux sont publiés dans la revue Nouvelle critique durant l’année 1953.
Les positions du PCF de l’après-Maurice Thorez sont donc synthétisées dans la résolution Sur les problèmes idéologiques et culturels de la réunion du Comité Central du PCF à Argenteuil le 13 mars 1966. L’intervention de Waldeck Rochet elle-même est publiée par la suite sous le nom de Le marxisme et les chemins de l’avenir.
Les thèses d’Argenteuil sont d’une importance extrême, elles fixent la vision du monde du PCF et marquent le passage définitif, sur les plans culturel et idéologique, dans le camp de l’interprétation de Maurice Thorez de la « démocratie ». Une généralisation culturelle et idéologique inacceptable pour la fraction qui, au sein de l’Union des Etudiants Communistes, entendait revivifier le marxisme-léninisme en profitant des thèses émises par Mao Zedong et du soutien implicite de l’intellectuel du PCF Louis Althusser.
 Elle scissionne donc, emportant une partie significative des cadres, pour former l’Union de la Jeunesse Communiste Marxiste-Léniniste, qui lutte pour la construction du « Parti Communiste de l’époque de la révolution culturelle ».
Elle scissionne donc, emportant une partie significative des cadres, pour former l’Union de la Jeunesse Communiste Marxiste-Léniniste, qui lutte pour la construction du « Parti Communiste de l’époque de la révolution culturelle ».
L’intellectuel Louis Althusser, lui, ne participera pas à ce saut ; il contribue, avec Etienne Balibar, à la « nouvelle » interprétation de l’État et de son appareil qui a lieu au sein du PCF. Althusser a développé le concept des « appareils idéologiques d’État » (droit, famille, informations, école, religion, etc.), dont il s’agit de briser l’hégémonie : la nécessité de la dictature du prolétariat n’a ainsi qu’une importance somme toute secondaire.
Si Althusser entend conserver tout de même le concept, tel n’est pas le cas de l’historien Jean Ellenstein, qui de 1972 à 1975 publiera une Histoire de l’URSS composée de petits ouvrages donnant la vision « officielle » du PCF. A ce niveau de questionnement idéologique du PCF, il faut noter que Jean Cogniot, membre du Comité Central de 1934 à 1964, joue également un grand rôle pour assurer la continuité.
C’est dans cette période transition suite qu’arrive mai 1968, un mouvement où le PCF n’a aucune influence, étant totalement débordé par ceux qu’il appelle les « gauchistes ». Les services d’ordre du PCF et la CGT s’étaient d’ailleurs confrontés physiquement aux cortèges maoïstes entendant défiler le premier mai ; « Gauchistes fascistes assassins » deviendra un slogan classique du PCF des années 1970.
 Alors que le 2 mai, la police est intervenue à la Sorbonne, Georges Marchais attaque dans L’Humanité du 3 mai 1968 les groupes de « fils de grand bourgeois » responsables de l’agitation ainsi que « l’anarchiste allemand Cohn-Bendit », qui tous font le jeu « du pouvoir gaulliste et des grands monopoles capitalistes ».
Alors que le 2 mai, la police est intervenue à la Sorbonne, Georges Marchais attaque dans L’Humanité du 3 mai 1968 les groupes de « fils de grand bourgeois » responsables de l’agitation ainsi que « l’anarchiste allemand Cohn-Bendit », qui tous font le jeu « du pouvoir gaulliste et des grands monopoles capitalistes ».
Marchais affirme que l’agitation n’est portée que par quelques centaines d’étudiants dont « les thèses ne peuvent que faire rire ». Pour le PCF, le mouvement de mai 1968 est un mouvement petit-bourgeois, porté de toutes manières par des étudiants dont 10% seulement proviennent de la classe ouvrière. Il est, de fait, totalement dépassé par les événements, faisant même tout pour freiner la propagation de l’agitation, que ce soit dans les entreprises ou dans les facultés. La bataille pour le système de sonorisation à la Sorbonne est restée dans les mémoires mais le PCF avait déjà l’habitude d’attaquer physiquement les meetings ou les vendeurs de la presse « gauchiste ».
Il faudra attendre la première nuit des barricades, du 10 au 11 mai, pour que le PCF appelle à la lutte « pour garantir les libertés syndicales et politiques », une intervention précédant d’une journée l’interdiction d’une douzaine d’organisations « gauchistes », ce qui ne saurait être un hasard : le PCF est ouvertement appuyé par l’État face au « chaos ».
 Le PCF et la CGT refusent de participer aux initiatives du syndicat étudiant UNEF ou à la grève générale de 24 heures du 13 mai : la stratégie est de court-circuiter le mouvement en cherchant l’alliance par en-haut avec la FDGS, la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste de François Mitterrand, en sachant pertinemment que le PCF est incontournable, de par son poids politique et électoral dans le pays, sans parler au sein de la gauche.
Le PCF et la CGT refusent de participer aux initiatives du syndicat étudiant UNEF ou à la grève générale de 24 heures du 13 mai : la stratégie est de court-circuiter le mouvement en cherchant l’alliance par en-haut avec la FDGS, la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste de François Mitterrand, en sachant pertinemment que le PCF est incontournable, de par son poids politique et électoral dans le pays, sans parler au sein de la gauche.
Ainsi, si Waldeck Rochet affirme le 24 mai : « Le problème du pouvoir reste posé. Le régime gaulliste a fait son temps. Il doit s’en aller » et si on peut lire dans l’éditorial de L’Humanité, sous la plume de son rédacteur en chef : « Le gouvernement actuel ne représente plus rien. Il ne faut plus ruser. Il faut partir », le quotidien du PCF parle pareillement de « la lie » pour désigner les dizaines de milliers de jeunes défilant le 24 mai contre l’interdiction de séjour de Daniel Cohn-Bendit. Il voit naturellement comme un concurrent la « nouvelle gauche » qui organise un rassemblement au stade Charléty (PSU, CFDT, UNEF, SNES SUP, JCR...), rassemblement qu’il rejette, ainsi que la proposition faite par Mitterrand de formation d’un « gouvernement provisoire ». Les 25 et 26 mai, le PCF et la CGT seront alors en première ligne pour signer les fameux « accords de Grenelle » censés en finir avec la contestation, qui marquent des améliorations sociales mais seront même rejetés par la base avant le retour triomphal de Charles De Gaulle quelques jours plus tard et la vague électorale gaulliste du 30 juin 1968 (293 sièges sur 378).
Les événements passés, la principale figure intellectuelle conservatrice, Raymond Aron, peut affirmer le 4 juin 1968 dans le principal quotidien conservateur, Le Figaro :
« A aucun moment le Parti communiste et la CGT n’ont poussé à l’émeute, à aucun moment ils n’ont voulu abattre le pouvoir gaulliste, dont la politique étrangère comble leurs voeux (...). Ils auraient évidemment pris en charge l’État si celui-ci leur avait été livré. Mais ils ont eu pour objectif constant non de « faire la révolution », mais de ne pas se laisser déborder sur leur gauche par les étudiants, par les maoïstes, par les jeunes ouvriers. »
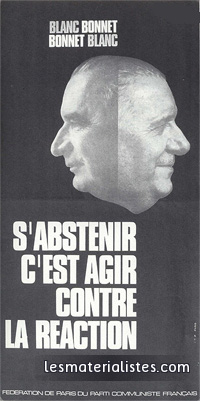 C’est une véritable débâcle pour la gauche, mais le PCF est satisfait d’avoir pu sauver les meubles, d’autant plus qu’une grande fronde interne se développe suite à l’intervention durant l’été des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie, pour « ré-instaurer l’ordre ».
C’est une véritable débâcle pour la gauche, mais le PCF est satisfait d’avoir pu sauver les meubles, d’autant plus qu’une grande fronde interne se développe suite à l’intervention durant l’été des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie, pour « ré-instaurer l’ordre ».
Waldeck Rochet se charge de préciser la « réprobation » du PCF. Et c’est également lui qui présente le Manifeste du Comité central du Parti Communiste Français : Pour une démocratie avancée pour une France socialiste !, également appelé Manifeste de Champigny, du lieu où s’est tenue la réunion les 5 et 6 décembre 1968. Waldeck Rochet, alors secrétaire général du Parti, y présente l’interprétation officielle par le PCF du mouvement de mai 1968, mouvement refusé au nom de... la révolution, que seul le PCF peut mener.
Waldeck Rochet y affirme :
« Aux travailleurs qui aspirent à une société plus juste, il faut savoir expliquer que le socialisme est précisément le régime où l’ouvrier travaille enfin pour lui-même et pour la société formée de travailleurs libres et égaux. Il faut que les travailleurs sachent que le but du socialisme et du communisme c’est tout à la fois de libérer les hommes de l’inégalité sociale et de toutes les formes d’oppression et d’exploitation, de garantir le bien-être du peuple entier, de permettre la libre expansion des facultés humaines en chaque personne.
Il faut que les travailleurs sachent que pour réaliser l’idéal du socialisme, il s’agit de faire disparaître les classes antagonistes et de supprimer l’exploitation de l’homme par l’homme, cela en abolissant la propriété capitaliste et en socialisant les principaux moyens de production, ce qui exige la conquête et la direction du pouvoir politique par la classe ouvrière et ses alliés (...) La noblesse d’un tel idéal [le socialisme] explique qu’en raison même de sa résonance, le mot socialisme soit exploité de tous côtés et mis à toutes les sauces, et cela, surtout en ce qui concerne les conditions de sa réalisation. C’est ainsi que les réformistes et les opportunistes de droite - même quand ils s’en défendent - présentent comme du socialisme ce qui n’est qu’un simple aménagement du capitalisme. (...)
D’aucuns parlent d’une « Révolution progressive et permanente », mais dans la mesure où cette expression sert à désigner une transformation insensible du capitalisme par l’accumulation de réformes partielles, il s’agit en réalité d’une variété de réformisme dont le capitalisme peut fort bien s’accommoder. (...) Les réformistes et les opportunistes de droite abolissent l’idée du bond révolutionnaire, à laquelle doit conduire précisément l’évolution graduelle, en cachant que la question fondamentale de toute Révolution est celle du pouvoir et que les classes exploiteuses doivent être définitivement écartées du pouvoir politique au profit de la classe ouvrière et de ses alliés, les classes moyennes des villes et des campagnes (...).
Quant aux gauchistes, ils rejoignent pratiquement les réformistes dans l’escamotage de cette question du pouvoir politique (...). Ils prétendent instituer l’autogestion dans l’entreprise, quel que soit le mode de propriété, c’est à dire sans toucher à la propriété privée des moyens de production et sans changer l’État bourgeois par un État socialiste. Mais on se perd en conjonctures sur ce que pourrait signifier l’autogestion dans une entreprise demeurée au pouvoir des monopoles au sein d’un État capitaliste : de tels mots d’ordre ne représentent qu’un néant, un cri en l’air, un vain bavardage (...).
Est ce à dire que les communistes seraient contre les réformes ? Non ! Comme le souligne le document soumis au Comité Central, les communistes sont, au contraire, pour toutes les réformes qui sont utiles à la classe ouvrière et aux autres travailleurs, mais ils sont contre le réformisme, c’est à dire la limitation de l’action aux changements compatibles avec les bases de l’ordre capitaliste, contre la soumission de la classe ouvrière à l’idéologie et à la politique de la grande bourgeoisie (...).
Les communistes disent qu’à l’aide de réformes, on peut obtenir des améliorations partielles, quelquefois très précieuses, mais qu’elles ne suffisent pas pour abolir la domination capitaliste ; elles peuvent être utiles à la Révolution socialiste, préparer le terrain pour le resserrement des rangs des forces démocratiques et pour l’isolement de l’oligarchie capitaliste et son affaiblissement. Les communistes considèrent qu’il faut utiliser les réformes pour rapprocher l’heure du socialisme. »
3. Document : « Faut-il réviser le marxisme-léninisme ? »
Roger Garaudy, membre du Comité central depuis 1945, député PCF puis sénateur, a été le philosophe officiel du PCF durant l’après-guerre. Il participe fermement à la « déstalinisation » et émet des thèses faisant du marxisme un « humanisme », thèses qui influencent notamment la réunion du Comité Central du PCF à Argenteuil le 13 mars 1966 et sa résolution intitulée Sur les problèmes idéologiques et culturels.
Cette résolution servira notamment de prétexte à la majorité de l’Union des Etudiants Communistes pour rompre avec l’organisation mère pour fonder l’Union de la Jeunesse Communiste (Marxiste-Léniniste) (UJCML). Il faut néanmoins noter que Roger Garaudy tentera de faire avancer trop vite le PCF en direction de ses propres thèses ; il sera ainsi exclu du PCF le 9 juin 1970 pour entretenir des rapports trop ouverts avec la social-démocratie et la franc-maçonnerie. Le PCF profitera alors pendant un temps des thèses de Louis Althusser, qui n’a pas suivi l’UJCML dont il était proche à un moment.
« Chose étrange et monstrueuse : « Il y a un humanisme marxiste. » Ainsi en a-t-il été décidé par un vote unanime du Comité Central du Parti Communiste Français. « Il y a... » II y a un socialisme utopique : Il y a Saint-Simon. Il y a Fourrier. Cela signifie-t-il que le socialisme est une utopie ? Le jeune Marx écrit ses Manuscrits de 44 : il est encore humaniste. Marx écrit le Capital : il s’est débarrassé de l’humanisme.
Garaudy écrit : « De l’anathème au dialogue ». Ce marxiste s’est converti à l’humanisme. Il y a du Garaudy. Il y a du jeune Marx. N’en doutons plus : II y a un « humanisme marxiste ». Il y a un humanisme marxiste. Cela signifie-t-il que le marxisme est un humanisme ? Ou bien, a-t-on voulu dire qu’il y a eu le jeune Marx ? Qu’il y a eu Garaudy ?
Savante ambiguïté !
« II ne faut pas introduire d’allusions dans une résolution » a écrit Lénine, dans le tome vingt-sept, à la page 118 de ses Oeuvres publiées aux éditions de Moscou et traduites en français sous la responsabilité de Roger Garaudy. Si le marxisme est un humanisme, nombre de conclusions doivent être tirées. A propos de la culture et des intellectuels, à propos de la science et de la révolution, à propos de la morale et des chrétiens, à propos enfin de l’idéologie et de l’unité. Citer ces conclusions, c’est mesurer l’importance de la résolution rapportée par Aragon. Qu’ici lui en soit rendu hommage : Aragon avec une application qu’on lui connaissait à peine, est allé jusqu’au bout. Le texte qui suit a pour but de définir ce point d’arrivée : un social-populisme de nuance chrétienne. (...)
Qui dit politique dit lutte des classes, Aragon en conviendra. La lutte des classes, c’est une guerre acharnée où tout est mis à contribution : trésors de la culture compris. Pour les marxistes-léninistes, il ne peut y avoir qu’une politique culturelle ; ils ne peuvent défendre abstraitement la culture. Une politique culturelle ne « régente « pas la culture : elle ne dit pas aux écrivains ce qu’ils doivent écrire, aux peintres ce qu’ils doivent peindre. Mais la culture peut être une forme spécifique directe de la lutte des classes.
Si la culture devient une arme des classes ennemies, le pouvoir des travailleurs a le devoir de la réprimer. Comment ? par une limitation de la diffusion, par une campagne éducative de presse, par une interdiction, voire par une condamnation, selon les cas concrets.
D’autre part, le Parti de la classe ouvrière encourage par tous les moyens une culture authentiquement populaire. La culture populaire est l’objet spécifique des écrivains ou artistes communistes. Elle ne tient pas dans un thème décrété populaire : les ouvriers, disait Lénine, ne veulent pas de littérature pour ouvriers. Elle a pour fonction d’élever la conscience culturelle et politique des classes populaires ; pour ce faire, elle doit se donner les moyens de s’adresser à ces classes.
Cette culture prend un sens différent quand le parti n’a pas encore pris le pouvoir ou au contraire quand il dirige déjà la construction du socialisme. Brecht dramaturge ne tient pas la même place qu’un Brasillach. Si des hommes, par l’écriture ou tout autre moyen de l’art, attaquent le pouvoir des Soviets, ils ne doivent pas échapper à la loi.
Car il n’y a pas d’hommes : mais le capital, la classe ouvrière, la paysannerie, les intellectuels. Cessez donc de parler du passé : parlez des intellectuels français dans les conditions nouvelles de notre époque. (...)
Précisons : « Les intellectuels soucieux de se libérer des contraintes matérielles et idéologiques que la bourgeoisie impose à leur activité ne peuvent que rechercher l’alliance avec la classe ouvrière. » (Section I. [de la résolution du PCF]) On n’en croit pas ses yeux : des intellectuels ne pourraient-ils pas chercher l’alliance avec la classe des capitalistes ? Mais s’ils ne la cherchent pas, c’est qu’elle est toute trouvée.
Aragon, calmez-vous, nous allons reprendre par le commencement. Si les intellectuels se soucient de se libérer des « contraintes », c’est que ces contraintes existent, au moins aussi pesantes que pour vous la vérité est légère. Les conditions matérielles, disons : l’argent, font bien les choses. Mais la liberté, l’égalité, la fraternité font mieux : cette monnaie est plus courante chez les intellectuels. Rappelez-vous ce que disait Lénine : spontanément, l’intellectuel fait sienne l’idéologie dominante. Qu’est-ce que l’idéologie dominante ? Celle de la classe dominante. Des monopoles, en l’occurrence. Et puis l’État, celui des monopoles, est large : il y a de la place pour les intellectuels dans l’administration, dans les conseils d’administration. Concluons : vous vous êtes trompé. (...)
Kautsky prenait un concept « la dictature du prolétariat » pour un mot. Pour ce petit mot, Lénine n’a rien fait de moins que l’Internationale communiste. C’est que de mot en mot...
Savez-vous où Kautsky en est arrivé ? à déclarer que la conquête du socialisme pouvait se faire par la voie démocratique. Tant il est vrai que tout a une fin, même dans le monde inachevé des révisionnistes. Aragon, lui, raffine. Il se paie le luxe, à escompter sur le trésor de la culture, de parler le langage de Lénine presque jusqu’au bout. « L’unité de la classe ouvrière et l’union de toutes les forces intéressées à l’établissement d’une démocratie véritable se prolongeront, comme il est souhaitable, pour la conquête, l’édification, et le maintien du socialisme, par les voies démocratiques. »
Au début, Aragon reprend la théorie léniniste de l’unité de la révolution ininterrompue et du développement par étapes : théorie chèrement acquise contre les opportunistes de droite et de gauche. A la fin, Aragon redescend à Kautsky. Pour être monté plus haut, Aragon descend plus bas. De l’humanisme à Kautsky, la ligne est droite. De la science marxiste à Lénine, la ligne est conséquente. Avec l’humanisme, maillon de bois, c’est toute la chaîne du marxisme-léninisme qui rompt. »

