L'Italie fasciste et l'antifascisme - 9e partie : un syndicalisme nationaliste de masse
Submitted by cavia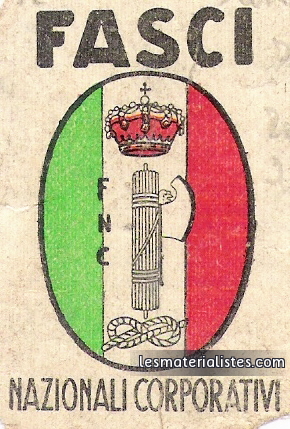 La gauche, à la suite du bienno rosso, a de plus en plus perdu les masses. Les fascistes ont réussi à happer des secteurs entiers dans le corporatisme, c'est-à-dire le syndicalisme révolutionnaire sans la révolution, l'énergie sociale-révolutionnaire passant dans le nationalisme.
La gauche, à la suite du bienno rosso, a de plus en plus perdu les masses. Les fascistes ont réussi à happer des secteurs entiers dans le corporatisme, c'est-à-dire le syndicalisme révolutionnaire sans la révolution, l'énergie sociale-révolutionnaire passant dans le nationalisme.
On reste dans l'apolitisme, au nom de l'anti-parlementarisme, mais la sortie n'est plus une hypothétique révolution, mais la transformation nationale-révolutionnaire.
Benito Mussolini est historiquement le dirigeant socialiste qui a le plus accepté et soutenu le syndicalisme révolutionnaire.
C'est paradoxal, car le syndicalisme révolutionnaire se pose comme anti-socialiste : la social-démocratie est considérée comme réformiste par nature et la politique comme une source de corruption institutionnelle et de division.

Mais c'est justement que Benito Mussolini représente un esprit de synthèse, celui entre le syndicalisme révolutionnaire et la révolution nationale comme « moteur », en remplacement de la révolution socialiste.
Le subjectivisme des syndicalistes révolutionnaires, théorisé principalement par Georges Sorel, accouplé au rejet du matérialisme comme idéologie, a fortiori du matérialisme dialectique, a fait que le pessimisme quant aux perspectives de révolution a été remplacé en optimisme nationaliste.
La bataille pour l'Italie, présentée comme « nation prolétaire », apparaît comme une grande source de mobilisation de masse, de possibilité de renouvellement social.
Benito Mussolini est ici l'homme clef, celui qui combine, qui reformule, qui unifie, qui synthétise, lorsqu'il affirme dans le Popolo di Trento, en 1909 :
« Je crois que c'est de la masse ouvrière, purifiée par la pratique syndicaliste, que sortira le nouveau caractère humain. »
 Benito Mussolini réussit, en fait, là où le Cercle Proudhon avait échoué en France, dans sa synthèse du syndicalisme révolutionnaire et du nationalisme de l'Action française.
Benito Mussolini réussit, en fait, là où le Cercle Proudhon avait échoué en France, dans sa synthèse du syndicalisme révolutionnaire et du nationalisme de l'Action française.
Lorsque la direction du syndicalisme révolutionnaire se lance dans le soutien à la guerre, au nom du « travail » soutenant la patrie, et que la victoire arrive, il y a comme une légitimité historique à s'approprier le sort de la nation, à devenir des « travailleurs » en lieu et place de « prolétaires ».
A la rupture culturelle et idéologique voulue par les communistes, le syndicalisme révolutionnaire oppose l'esprit de producteur capable de gérer sa production.
A ce titre, l'Union Italienne du Travail, fondée en 1918, combinait lutte sociale et nationalisme ; lorsqu'en mars 1919 une grève générale est organisée par cette structure dans un atelier de métallurgie dans la région de Bergame, les ouvriers pratiquant la première expérience d'autogestion italienne agitent le drapeau italien comme bannière.
C'est Benito Mussolini qui harangua les grévistes avant de fonder justement une semaine après les Faisceaux Italiens de combat.
Voici ce qu'il dit notamment aux grévistes, témoignant de cette fusion de volontarisme syndicaliste révolutionnaire et d'esprit gestionnaire « responsable » d'orientation nationaliste :
« L'avenir du prolétariat est un problème de capacité et de volonté, non pas uniquement de volonté, non pas uniquement de capacité, mais tout à la fois de capacité et de volonté...
C'est le travail qui s'exprime par vos lèvres. C'est le travail qui, dans les tranchées, s'est conquis le droit de n'être plus fait et symbole de fatigue et de désespoir, celui de devenir synonyme d'orgueil, de création, de conquête pour des hommes libres, évoluant dans une Patrie libre et grande, tant dans les limites de ses frontières qu'au dehors. »
Mieux encore, leur expérience représente l'avenir :
« Vous obscurs travailleurs de Dalmine, vous avez ouvert l'horizon. C'est le travail qui parle en vous, non pas le dogme idiot ou l'église intolérante, bien que rouge, c'est le travail qui a consacré dans les tranchées son droit de ne pas être plus de fatigue, de pauvreté ou de désespoir, parce qu'il doit devenir la joie, l'orgueil, la création, la conquête de l'homme libre dans la patrie libre et grande au-delà des frontières. »
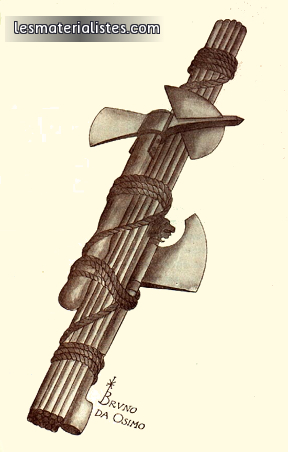 C'est cette démarche qui triomphe, à partir de 1922, avec la Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali, qui a dès le départ 800 000 adhérents. Au tout début de 1925, elle a 1,7 million d'adhérents, 2,3 millions à la fin de l'année.
C'est cette démarche qui triomphe, à partir de 1922, avec la Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali, qui a dès le départ 800 000 adhérents. Au tout début de 1925, elle a 1,7 million d'adhérents, 2,3 millions à la fin de l'année.
Bien sûr, cette orientation, ouvertement dans une logique de collaboration entre les classes sociales, amena une rupture avec certains syndicalistes-révolutionnaires nationalistes désirant « sincèrement » la révolution ; le plus connu fut Alceste de Ambris, qui se réfugia en France et devint un opposant au fascisme.
Les autres devinrent les grands théoriciens du fascisme : Sergio Panunzio surtout, le grand précurseur de la conception corporatiste, mais aussi Michele Bianchi, Edmondo Rossoni, ce dernier tentant de développer une ligne de « gauche » au sein de la collaboration de classes, ce qui lui valut d'être relativement mis à l'écart.
