Denis Diderot et le matérialisme - 4e partie : la conception matérialiste de Diderot
Submitted by Anonyme (non vérifié)L'approche de Diderot est un matérialisme, mais un matérialisme qui sera par la suite appelé « vulgaire », au sens où il parvient à affirmer le caractère matériel de l'être humain, mais n'arrive pas à saisir le principe d'une organisation globale de la matière par elle-même.
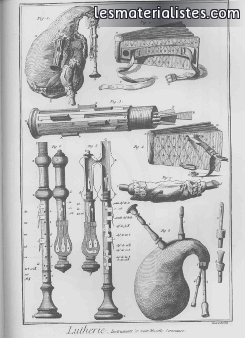 L'être humain est vu ainsi non pas comme dépendant du système, mais comme en quelque sorte « à côté » de celui-ci, même si – et là est le paradoxe – il est admis de manière matérialiste que l'être humain ne dispose pas de « liberté ».
L'être humain est vu ainsi non pas comme dépendant du système, mais comme en quelque sorte « à côté » de celui-ci, même si – et là est le paradoxe – il est admis de manière matérialiste que l'être humain ne dispose pas de « liberté ».
Le matérialisme de Diderot reste ainsi bloqué au niveau individuel. D'où sa force, dans la mesure où il est compris que le « bien » et le « mal » ne sont pas des catégories divines, mais quelque chose à interpréter par rapport à ce qui va ou non dans le sens de la vie.
Mais d'où sa faiblesse, dans la mesure où l'être humain est saisi correctement comme une « machine », mais une machine sans « ordinateur central ».
C'est ce qui fait que Diderot peut prolonger Spinoza mais en revenir à Épicure : il y a le matérialisme, mais pas la compréhension du système.
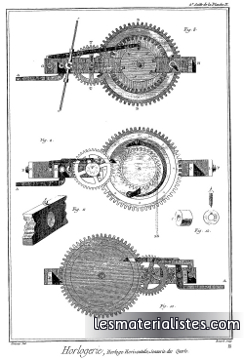 Il faudra attendre Karl Marx et Friedrich Engels, dans le prolongement de Feuerbach et de Hegel, pour affirmer que le système est l'univers en auto-transformation et qu'ainsi si les êtres humains sont bien des machines, ils ne font que refléter non pas simplement les « besoins physiques », mais justement la transformation de l'univers lui-même.
Il faudra attendre Karl Marx et Friedrich Engels, dans le prolongement de Feuerbach et de Hegel, pour affirmer que le système est l'univers en auto-transformation et qu'ainsi si les êtres humains sont bien des machines, ils ne font que refléter non pas simplement les « besoins physiques », mais justement la transformation de l'univers lui-même.
Et Le Capital de Marx explique justement comment cette transformation passe dans les consciences par l'intermédiaire des besoins physiques, c'est-à-dire matériellement ce qui a été appelé le mode de production.
Voici inversement une lettre de Denis Diderot à l'écrivain Paul-Louis Landois, en date du 29 juin 1756.
On voit comment Diderot prolonge Spinoza sur la négation du « bien » et du « mal » comme valeurs d'un Dieu « pensant ». Mais on voit aussi comment il ne parvient pas à saisir la transformation du réel, basculant dans un matérialisme moraliste et passif propre à l'épicurisme.
Cela est conforme aux exigences de la bourgeoisie, qui profite de cet « épicurisme » pour enfin revendiquer l'existence d'une matière à transformer par le capitalisme... Sans pour autant reconnaître l'ensemble comme un système (ce que feront donc inversement Karl Marx et Friedrich Engels, avec la classe ouvrière).
« C'est ici, mon cher, que je vais quitter le ton de prédicateur pour prendre, si je peux, celui de philosophe.
Regardez-y de près, et vous verrez que le mot liberté est un mot vide de sens ; qu'il n'y a point et qu'il ne peut y avoir d'êtres libres ; que nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre général, à l'organisation, à l'éducation et à la chaîne des événements. Voilà ce qui dispose de nous invinciblement.
On ne conçoit non plus qu'un être agisse sans motif, qu'un des bras d'une balance agisse sans l'action d'un poids, et le motif nous est toujours extérieur, étranger, attaché ou par une nature ou par une cause quelconque, qui n'est pas nous.
Ce qui nous trompe, c'est la prodigieuse variété de nos actions, jointe à l'habitude que nous avons prise tout en naissant de confondre le volontaire avec le libre.
Nous avons tant loué, tant repris, nous l'avons été tant de fois, que c'est un préjugé bien vieux que celui de croire que nous et les autres voulons, agissons librement. Mais s'il n'y a point de liberté, il n'y a point d'action qui mérite la louange ou le blâme; il n'y a ni vice ni vertu, rien dont il faille récompenser ou châtier.
Qu'est-ce qui distingue donc les hommes ? la bienfaisance et la malfaisance.
Le malfaisant est un homme qu'il faut détruire et non punir; la bienfaisance est une bonne fortune, et non une vertu. Mais quoique l'homme bien ou malfaisant ne soit pas libre, l'homme n'en est pas moins un être qu'on modifie; c'est par cette raison qu'il faut détruire le malfaisant sur une place publique.
De là les bons effets de l'exemple, des discours, de l'éducation, du plaisir, de la douleur, des grandeurs, de la misère, etc.; de là une sorte de philosophie pleine de commisération, qui attache fortement aux bons, qui n'irrite non plus contre le méchant que contre un ouragan qui nous remplit les yeux de poussière.
Il n'y a qu'une sorte de causes, à proprement parler; ce sont les causes physiques.
Il n'y a qu'une sorte de nécessité; c'est la même pour tous les êtres, quelque distinction qu'il nous plaise d'établir entre eux, ou qui y soit réellement. Voilà ce qui me réconcilie avec le genre humain; c'est pour cette raison que je vous exhortais à la philanthropie.
Adoptez ces principes si vous les trouvez bons, ou montiez-moi qu'ils sont mauvais. Si vous les adoptez, ils vous réconcilieront aussi avec les autres et avec vous-même : vous ne vous saurez ni bon ni mauvais gré d'être ce que vous êtes.
Ne rien reprocher aux autres, ne se repentir de rien : voilà les premiers pas vers la sagesse. Ce qui est hors de là est préjugé, fausse philosophie. »
